| Cote(s) ancienne(s) | F. Av ; ff. 1-39 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datation | 1145-1155 (Holtz 2000) | ||||||||||||||
| Langue(s) |
|
||||||||||||||
| Description matérielle brève |
|
FF. 1-39 (39 ff.)
248 × 145 mm
parchemin
Nombreuses traces d’usure et d’humidité.
Formule ; 1 8-2 8, 3 8+1, 4 8, 5 6
Collation : 1 8 (1-8) 2 8 (9-16), 3 8+1 (17-25), 4 8 (26-33), 5 6 (34-39).
Cahiers signés à la fin de .I. à .V.
Irrégularités : dans le cahier 3, de type 5/4, le f. 20 est solidaire d’un talon visible après le f. 22. Dans le cahier 4, les f. 28 et 31 sont des feuillets séparés assemblés par collage. Cahier 5 : les ff. 34 et 39 assemblés par collage et les ff. 36 et 37 sont cousus ensemble ; le f. 35 présente la particularité de se déplier, le texte étant copié des 2 côtés du rabat.
Caroline. « écriture française, de type anglo-normand, une main principale, sans doute unique sous des variations de style, exceptionnellement relayée par une seconde main ff. 5-16 » (Holtz 2000, p. 29-30).
-
Texte : Initiales à motifs végétaux ou palmaires, filigranées, à l’encre de couleur, puis initiales monochromes sans ornement, de couleur verte ou roue. Ff. 17-26 : les données chiffrées des Tables faciles de Ptolémée sont mises en scène dans un décor, en vert et rouge, de colonnades surmontées d’arceaux.
Illustrations : Schémas géométriques (ff. 26, 32v-39v) dont 3 (ff. 32v-33rv) mettant en scène un personnage figuré.
-
-
n. r.
n. r.
| Division | F. Av |
|---|---|
| Numérisations |
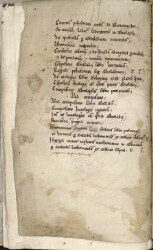
|
| Titre donné par le manuscrit | s. t. |
| Identification | Sommaire |
Intitulé de début : –
Incipit :
Canones Ptholomei utiles ad astronomiam […](f. Av)
Explicit :
[…] in ast(ro)nomia(m) p(er) Adelardu(m) Bathoniense(m) ex arabico su(m)pta. l. I us. (f. Av)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : –
Sommaire de la fin du XII e (Jeudy & Riou 1989) ou du XIII e (Holtz 2000).
2 textes annoncés dans la table sont aujourd’hui manquants : Astronomicorum prestigiorum Thebidis secuncum Ptolomeum et Hermetem par Adelardum Bathoniensem ex arabico translatus l(iber) I us ; Isagoga minor Iapharis mathematici in astronomiam per Adelardum Bathoniensem es arabico sumpta l(iber) I us par un deficit de feuillets entre les folios 76 et 77. Il reste la dernière page de l’ Isagoga minor (f. 78) ; certains titres ne rendent compte qu’imparfaitement des compilations recopiées.
Texte : -
Illustrations : -
Autres informations codicologiques : La f. A est une garde, qui est intégrée ici dans la première unité codicologique par convention. La table qu’elle porte au verso est plus tardive que le reste du manuscrit, étant écrite d’une main du xiii e s.
Analyse de la table en relation avec le contenu effectif du manuscrit dans sa foliotation actuelle :
n. r.
n. r.
Autres
| Division | Ff. 1r-26r | |
|---|---|---|
| Numérisations |
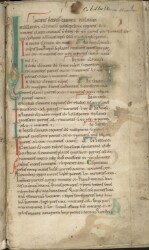
|
|
| Description matérielle |
|
|
| Titre donné par le manuscrit | s. t. | |
| Identification | Anonymus Preceptum et Canones Ptolomei, tables astronomiques avec manuel introductif |
Intitulé de début :
INCIPIT P(RE)CEPTV(M) CANONIS PTOLOMEI(f. 1r)
Incipit :
INTELLECTVS clymatv(m) polis episeme requires si in ueneris platos ciuitatis […](f. 1r)
Explicit :
[…] In Apogion uero q(uo)d intuleris & non inueneris req(ui)res sup(er)iorem & inferiorem, & addes aut deduces. (f. 16r)
Explicit (texte après la tables) :
[…] Sunt bis bina t(ri)ens e(st) q(ua)drans ipsi(us) un(um). (f. 26r)
Intitulé de fin : -
Formule conclusive : -
Annotation(s) : en 26r, « Iohannis », (Jeudy & Riou 1989 ; Holtz 2000 intègre Iohannis au v. 1 du poème)
Glose(s) : -
Séquence astronomique dédiée aux Tables faciles de Ptolémée :
Texte : Initiale bicolore (f. 1r) ; initiales rouges ou vertes.
Illustrations : Tableau (f. 12r) ; Tables faciles insérées dans un décor de colonnes et arceaux (ff. 17-26r) ; schéma géométrique accompagné d’indications lettrées et chiffrées : 4 triangles rectangles isocèles inscrits dans 1 carré lui-même inscrit dans 1 cercle (f. 26r).
Autres informations codicologiques : f. 16v blanc.
La source grecque du Preceptum canonis Ptolomei introduisant aux Tables faciles de Ptolémée n’est pas identifiée. On reconnaît dans le Preceptum canonis Ptolomei des passages empruntés au Petit commentaire aux Tables faciles de Ptolémée de Théon d’Alexandrie (rédigé vers 377), mais d’autres éléments ne proviennent pas de Théon sans qu’on puisse en déterminer l’origine. Le Preceptum canonis Ptolomei dans sa version latine est daté du VI e siècle : Rome, vers 535 ? (Pingree 1997, 16). L’œuvre de Ptolémée comportait un mode d’emploi qui précédait la série de tables astronomiques, mais dans la tradition manuscrite grecque les deux parties de l’œuvre, manuel introductif et tables astronomiques, ont été transmises par des voies de transmission différentes. Théon d’Alexandrie a rédigé un Petit commentaire aux Tables faciles qui rencontra un grand succès, et un Grand commentaire, plus difficile et moins diffusé.
Le guide d’utilisation des Tables faciles rédigé par Ptolémée, Προχείρων κανόνων διάταξις καὶ ψηφοφορία, a été publié par Heiberg 1907 ; les Tables faciles ont été publiées par l’abbé Halma (Halma 1822-1825), une nouvelle édition critique est en cours (voir infra).
Dans le manuel introductif comme dans les tables, on note la présence d’expressions ou de mots non traduits, mais simplement translittérés du grec.
Le poème, accompagné d'une figure géométrique, recopié au f. 26r est aussi donné par le manuscrit Cambridge, Trinity College, R. 15.16 (Holtz 2000, 41).
Pingree D. (1997), The Preceptum Canonis Ptolomei, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant [sans édition des Tables faciles qui suivent le Preceptum Canonis Ptolomei, mais liste précisée, p. 17-18].
Halma N. (1822-1825), Commentaire de Théon d’Alexandrie sur le livre III de l’Almageste de Ptolémée. Tables manuelles des mouvements des astres, traduites[…] du grec[…] sur les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. l’abbé Halma… , Paris.
Heiberg J.L. (1907), Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 2., Leipzig, B. G. Teubner, p. 159-185.
Mercier R. (2011), Ptolemaiou Procheiroi Kanones. Ptolemy’s Handy Tables Volume 1b: Tables A1-A2. Transcription and Commentary, Louvain-la-Neuve, Peeters (PIOL 59a).
Tihon A. (2011), Ptolemaiou Procheiroi Kanones. Les « Tables faciles » de Ptolémée. Volume 1a : Tables A1-A2. Edition, Louvain-la-Neuve, Peeters (PIOL 59b).
voir supra Pingree D. (1997)
Juste D., ‘Ptolemy, Preceptum canonis Ptolomei (tr. before c. 1000)’ (update: 06.01.2023), Ptolemaeus Arabus et Latinus. Works, URL = http://ptolemaeus.badw.de/work/52.
Juste D., 'Ptolemy, Handy Tables (Greek)' (update 18/08/2024), Ptolemaeus Arabus et Latinus, Works, URL = http://ptolemaeus.badw.de/work/153
Sources scientifiques
Traités d’astronomie
| Division | Ff. 26v-32v | |
|---|---|---|
| Numérisations |
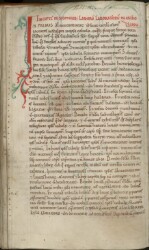
|
|
| Description matérielle |
|
|
| Titre donné par le manuscrit | s. t. | |
| Identification | Anonymus [Compilation astronomique sur les usages de l’astrolabe] | |
| Langue(s) | Lexique de l’astrolabe établi à partir des dénominations arabes : présence d’expressions ou de mots translittérés de l’
|
Intitulé de début :
INCIPIT DE NOMINIBVS LABORVM LABORATORVM IN ASTROLAPSV(f. 26v)
Incipit :
IN PRIMIS almuncantarat id sunt circuli et arcus iacentes in sculpa in ipsa tabula […](f. 26v)
Explicit :
[…] tanta erit altitudo dep(ic)ta stat(ur)a. H(ae)c monstrat nob(is) suiecta figura.(f. 32v)
Intitulé de fin : -
Formule conclusive : -
Annotation(s) : -
Glose(s) : -
Compilation astronomique dédiée à l'explication et à la promotion des usages de l’astrolabe, hétérogène dans les pièces réunies mais cohérente dans son propos et sa logique interne. Elle rassemble les textes suivants :
Texte : Grand I à queue palmée (f. 26v) : initiale de l’incipit In Primis. Grand A à motif végétal et palmes (f. 27v) : initiale de l’incipit. Puis lettre ornées aux incipit des différents passages.
Illustrations : schéma illustrant une mesure de hauteur par simple visée à 45° à l'aide d'un quart d'astrolabe (f.32v) ; schéma du fonctionnement d'un cadran stellaire, incluant un personnage - l'opérateur visant le pôle à travers un tube de visée déduit l'heure à partir de la rotation d’une étoile repère autour du pôle (f. 32v).
Autres informations codicologiques : Il ne semble pas y avoir une correspondance exacte entre la notice du f. 30r et la figure du f. 39v à laquelle renvoie l’annotation marginale.
La collection de textes connue sous le titre de Sententiae astrolabii (sigle J’), telle qu’éditée par Millàs Vallicrosa 1931 comporte trois sections :
Les indications de la latitude et de la longueur du jour le plus long fournies par la table des climats bilingue copiée f. 29r ont sans doute été transcrites, puis traduites, d’après les intitulés de début gravés sur les tympans d’un astrolabe arabe comparable à celui reproduit dans le manuscrit Paris, BNF 7412, ff. 19v-23v (Kunitzsch 1998 [2004] ; Kunitzsch 2000). Dans la tradition manuscrite, on trouve la table parfois insérée dans le traité sur les usages de l’astrolabe De utilitatibus astrolabii I (sigle J) traditionnellement attribué à Hermann de Reichenau ( Hermannus Contractus 🔎 ) - voir PL 143, c. 402-403 - ou à Gerbert d’Aurillac ( Silvester II 🔎 ), Liber de astrolabio 18, 3 - voir Bubnov 1899, 141-142.
La table a été publiée par Millàs Vallicrosa 1931 comme élément d’une collection sur les usages de l’astrolabe plan que Millàs Vallicrosa met en relation avec les traités Sententiae astrolabii (sigle J’) ou De horologio secundum alkoram id est speram rotundam (sigle J’a) et qu'il a publié en section II E (Millàs Vallicrosa 1931, 290-293). Les notices Ut scias quot gradus unumquodque signum (f. 31v) et In quibus signis sint stellae horarum (f. 32r), correspondent à des textes présents dans cette même collection.
Au f. 30r, les instructions pour représenter la sphère céleste, avec ses principaux cercles reprennent des données chiffrées traditionnelles conformes à la description de la sphère céleste par Hygin. Une annotation marginale renvoie au schéma du f. 39v.
La représentation et la brève notice de cadran stellaire du f. 32v sont à rapprocher de l’ horologium nocturnum de Pacificus de Vérone 🔎 (Wiesembach 1993, Wiesenbach 1994). Autres représentations (sans notice) dans Paris, BNF lat. 7412, f. 15r et London, BL, Royal 15 B IX, f. 77r ; liées à la tradition du poème de Pacificus de Vérone dans Venezia, Biblioteca Nazionale Maricana, lat. VIII. 22, f. 1r ; Vaticano, BAV, Vat. lat. 644, f. 76r ; St Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. sang. 18, p. 43. Description de l’ horlogium nocturnum par Pacificus de Vérone lui-même dans le poème Spera coeli quater senis horis (K. Strecker (éd.), MGH Poetae 4, 2, p. 692, n° 116).
Burnett C. (1984), « The Contents and Affiliation of the Scientific Manuscripts Writte at, or Brought to, Chartres at the Time of John Salisbury », in The World of John Salisbury, M. Milks (éd), Oxford, Studies in Church History (Subsidia ; 3), p. 152.
Lindsay W. M. (éd.) (1911), Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum siue Originum libri XX, Oxford, Clarendon Press (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis).
Bubnov N. (1899), Gerberti postea Silvestri II papae Opera Mathematica. Accedunt aliorum opera ad Gerberti libellos aestimandos intelligendosque necessaria per septem appendices distributa […] Berlin, Hildesheim, Olms, 1963 ; Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Verlag, 2005.
Migne J.-P (éd.) (1853), Hermanni Contracti monachii Augiae divitis […] Opera omnia, Paris, Migne Patrologiae cursus completus Series latina, 143).
Millás Vallicrosa J. M. (1931), Assaig d’història de les idees fisiques i mathemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelone.
Borelli A. (2008), Aspects of the Astrolab ‘architectonica ratio’ in tenth- and eleventh- century Europe, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (Sudhoffs Archiv 57), 2008
Kunitzsch P. (1987), « Al-Khwarizmi as a Source for the Sententie astrolabii », in From Deferent to Equant: A volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy , New York, Annals of the New York Academy of Sciences (vol. 500), p. 227-236 [rééd. Kunitzsch P. (1989), The Arabs and the Stars, Northampton, Variorum Reprints].
Kunitzsch P. (1998), « Traces of a Tenth-Century Spanish-Arabic Astrolabe », Zeitschrift für Geschichte der Arabish-Islamischen Wissenschaften 12, Francfort-sur-le-Main, p. 113-120, [reproduit dans Kunitzsch P., Stars and Numbers. Astronomy and Mathematics in the Medieval Arab and Western Worlds, Aldershot – Burlington, Asghate (Variorum Collected Studies), 2004].
Kunitzsch P. (2000), « La table des climats dans le corpus des plus anciens textes latins sur l’astrolabe », dans Science antique, Science médiévale (Autour d’Avranches BM 235). Actes du colloque international (Mont Saint-Michel, 4-7 septembre 1998), L. Callebat et O. Desbordes (éd.), Hildesheim – Zürich – New York, Olms-Weidmann.
Michel H. (1954), « Les tubes optiques avant le télescope », Ciel et Terre, Bulletin de la société belge d’astronomie, de météorologie et de physique du globe, 70, p. 175-184.
Poulle E. (1985), « L’astronomie de Gerbert », in Gerberto, scienza, storia e mito. Atti del Gerberti Symposium, Archivum Bobiense, Studia 2, p. 597-617.
Wiesenbach J. (1993), « Pacificus von Verona als Erfinder einer Sternenuhr », in Science in Western and Eastern Civilization in Carolingians Times, P. L. Butzer et D. Lohrmann (éd.), Basel – Boston – Berlin, Birkhäuser, p. 1054-1061.
Wiesenbach J. (1994), « Der Monch mit dem Sehzohr », Schweizerische Zeitschrift fur Geschichte, vol. 44, p. 367-388.
Sources scientifiques
Traités d’astronomie
| Division | Ff. 32v-38r | |
|---|---|---|
| Numérisations |

|
|
| Description matérielle |
|
|
| Titre donné par le manuscrit | s. t. | |
| Identification | Anonymus Geometria incerti auctoris III (extraits) |
Intitulé de début :
AD ALTV(M) CVM SAGITTIS ET FILO METIENDVM(f. 32v : titre du premier chapitre)
Incipit :
Si cui(us)libet rei altitudine(m) inuestigare, uolueris hui(us)modi militari ingeniolo inuestigare pot(er)is […](f. 32v)
Explicit :
[…] int(er)vallum stationu(m) m(en)soris alto aequale erit si duo duplu(m), si .III. triplu(m). Et sic in sequentibus.(f. 38r)
Intitulé de fin : -
Formule conclusive : -
Annotation(s) : -
Glose(s) : -
Chapitres de géométrie pratique appartenant à la collection connue comme Geometria incerti auctoris, l. III, depuis son édition par Bubnov 1899, 317-331) :
Texte : initiales monochromes en rouge ou en vert. Intitulés en rouge. Trais de séparation entre figures et texte environnant en rouge ou en vert.
Illustrations : Schémas géométriques, à l’encre rouge et verte, dont 2 mettant en scène un personnage figuré (f. 33rv).
Autres informations codicologiques : le f. 35 présente la particularité de se déplier, le texte étant copié des 2 côtés du rabat.
La collection de problèmes de géométrie pratique copiée dans Avranches BM 235 est attestée dans la tradition manuscrite sous différentes recensions. Elle est communément identifiée sous l’intitulé de Geometria incerti auctoris, l. III que lui a donné Bubnov 1899. Auparavant, la collection avait été publiée comme partie d’une collection géométrique attribuée à Gerbert d'Aurillac ( Silvester II 🔎 ) : Geometria Gerberti, cap. 14-40 par Pez 1721, Migne 1853, Olleris 1867. Contre cette attribution à Gerbert, Bubnov a considéré que la collection appartenait à une composition anonyme et acéphale (privée de ses deux premiers livres). Il en publié le texte d'après la recension longue fournie par les manuscrits qu'il a définis comme appartenant à la classe D.
La sélection de chapitres de la Geometria incerti auctoris présente dans Avranches BM 235 doit être rapprochée des compilations présentes dans les manuscrits de la classe E définie par Bubnov 1899, 315-316. Elle est très proche dans son organisation et ses variantes textuelles de la séquence conservée dans le manuscrit †Chartres BM 214 (selon le témoignage de Bubnov 1899).
En 33rv, le fragment Ad inveniendam altitudinem in plano sine astrolapsu est une particularité du manuscrit Avranches BM 235. La procédure préconisée (mesure d’une hauteur par simple visée à 45°) peut être rapprochée de celle proposée dans un bref fragment du corpus des agrimensores latins (incipit : Arborem sive turrem vel quodcumque fuerit excelsum…) édité par Bubnov 1899, 55 (l. 23)-551 (l .4) comme élément d’une collection attribuée à Epaphroditus et Vitruvius Rufus et parfois inséré dans la tradition interpolée du traité d'architecture de Cetius Faventinus (voir la compilation des extraits de Cetius Faventinus ff.47v-51).
En 34r, le fragment sur la description et l’utilisation du carré géométrique est répertorié comme GIA frgm. I depuis son édition par Millàs 1931, 302-303 section VI, l. 1-13. Il constitue une recension courte du fragment GIA Add. 5a Bubnov 1899, 365 (7-21), Construe quadratum de ligno .
En 36r, le chapitre sur la mesure des grandes profondeurs à l’aide d'un sondeur sans fil (et d'un bol plongeur comme un instrument de mesure du temps), est répertorié comme GIA, frgm. II depuis sont édition par Millàs Vallicrosa 1931, 303 section VI, l. 15-34. C'est une recension courte de la notice Quando queris altitudinem et profunditatem pelagi.
Bubnov N. (1899), Gerberti postea Silvestri II papae Opera Mathematica. Accedunt aliorum opera ad Gerberti libellos aestimandos intelligendosque necessaria per septem appendices distributa […] Berlin, (Hildesheim, Olms, 1963 ; Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Verlag, 2005)
Millás Vallicrosa J. M. (1931), Assaig d’història de les idees fisiques i mathemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelone.
Borelli A. (2008), Aspects of the Astrolab 'architectonica ratio' in tenth- and eleventh- century Europ, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (Sudhoffs Archiv 57), 2008
Jacquemard C. (2000), « Recherches sur la composition et la transmission de la Geometria incerti auctoris. À propos du De profunditate maris uel fluminis probanda, Avranches BM 235, f. 36 », in Science antique, science médiévale (Autour d’Avranches BM 235). Actes du colloque internationale (Mont Saint-Michel, 4-7 septembre 1998), L. Callebat et O. Desbordes (éd.), Hildesheim – Zürich – New York, Olms-Weidmann, p. 81-119.
Sources scientifiques
Traités de géométrie
| Division | Ff. 38v-39 | |
|---|---|---|
| Numérisations |

|
|
| Description matérielle |
|
|
| Titre donné par le manuscrit | s. t. | |
| Identification | Anonymus Compilation astronomique De mensura astrolapsus (h'') et pièces connexes |
Intitulé de début :
-
Incipit :
Phylosophie qui sua sapientia motus siderum conctaque officia firmamenti inuevenrunt et inventa luculentur […](f. 38v)
Explicit :
Si q(ua)rta IIII puncta si q(ui)naria V. In sequente pagina videbis hui(us) scripti figuram.(f. 39r)
Incipit (légende figure) :
Linea ducta pri(us) quarta p(ro) parte rotelle. Percipiat punctu(m) q(u)o uis componere centru(m). […](f. 39v)
Explicit (légende figure) :
[…] Et s(u)nt solstitii thropici limes Cap(ri)corni.(f. 39v)
Intitulé de fin : -
Formule conclusive : -
Annotation(s) : -
Glose(s) : -
Compilation astronomique sur la construction de l'astrolabe :
Texte : lettrine de couleur (verte) à queue palmée P (f. 38v) : initiale de l’incipit Phylosophi… ; lettres capitales indiquant les début de vers du poème Linea ducta... ;
Illustrations : 2 schémas de construction d’un tympan d’astrolabe illustrant le texte du De mensura astrolapsus (h'') : tracé des cercles célestes (f. 38v) et tracé des almucantars (f. 39v) ; schéma de construction de cercles célestes (f. 39v) sans rapport avec le traité .
Autres informations codicologiques : -
Le traité Philosophi qui sua sapientia motus siderum ( De mensura astrolapsus, h") sur la construction de l’astrolabe copié ff. 38v-39r fait partie de la strate la plus ancienne des traités latins sur l’astrolabe. Il a été attribué hypothétiquement par Millàs Vallicrosa à Llobet de Barcelone (Lupitus).
Son texte est ici accompagné de 2 schémas explicatifs, le premier (f. 38v), explique le tracé des cercles célestes d'un tympan d'astrolabe ; le second (f.39v) illustre le tracé des almuncantars. Il est annoncé, f. 39r, par l’annotation In sequente pagina videbis huius scripti figuram et il est assorti, f. 39v, d'une réserve inscrite en marge de gauche : adsimil(i)t(er) magis qua(m) ad iustiticiam rescripta.
Les autres pièces du f. 39v n'ont pas de source identifiée. Le contenu du poème Linea ducta... n’a pas de rapport immédiat avec le schéma du tracé des almuncantars qu'il semble pourtant légender. Il constitue une variante versifiée des instructions de la brève notice Quadrę unius lineam in XX partire... qui n’a, elle-même, pas de lien directe avec la figure du bas du folio 39v à laquelle parait l'associer la mise en page. Un système de renvoi associe cette figure au texte De designatione sperae (f. 30r) dont elle reprend le lexique et le principe de construction de la sphère céleste (avec application des données d'Hygin à une représentation plane ?)
Millás Vallicrosa J. M. (1931), Assaig d’història de les idees fisiques i mathemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelone.
Bergmann W. (1985), Innovationem im Quadrivium des 10 und 11 Jahrunderts, Studien zur Einf¨rung von Astrolab und Abakus im lateinischen Mittlealter, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (Sudhoffs Archiv 26), 1985
Borelli A. (2008), Aspects of the Astrolab 'architectonica ratio' in tenth- and eleventh- century Europ, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (Sudhoffs Archiv 57), 2008
Millás Vallicrosa J. M. (1931) voir supra
Sources scientifiques
Traités de géométrie