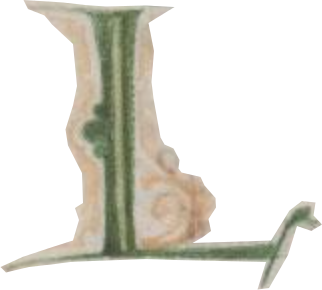 e Scriptorial
d’Avranches expose dans la salle des manuscrits (appelée aussi salle du Trésor) des volumes précieux issus de la Bibliothèque
patrimoniale d’Avranches. Vous accédez ici à l’exposition virtuelle des ouvrages montois que vous pourrez retrouver au musée. À partir de ces courtes descriptions, vous pouvez également consulter la notice catalographique réalisée
dans le cadre de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel.
e Scriptorial
d’Avranches expose dans la salle des manuscrits (appelée aussi salle du Trésor) des volumes précieux issus de la Bibliothèque
patrimoniale d’Avranches. Vous accédez ici à l’exposition virtuelle des ouvrages montois que vous pourrez retrouver au musée. À partir de ces courtes descriptions, vous pouvez également consulter la notice catalographique réalisée
dans le cadre de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel.
Exposition d'automne octobre à décembre 2025 : Tous les manuscrits mènent à Rome
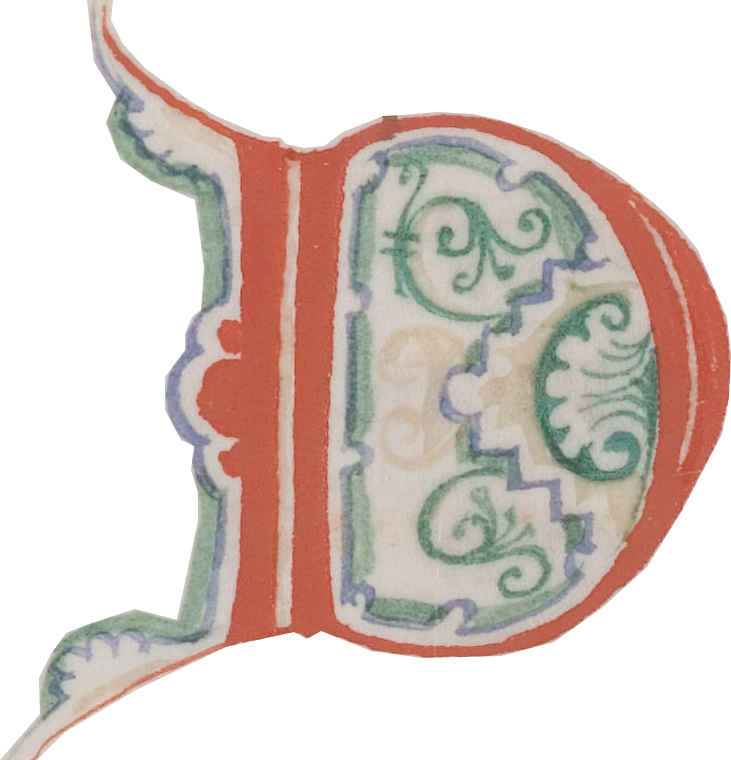 e sa naissance à son effondrement, l’Empire et les auteurs de référence qui en sont issus servent de modèle et de socle à la pensée des hommes de l’époque médiévale.
e sa naissance à son effondrement, l’Empire et les auteurs de référence qui en sont issus servent de modèle et de socle à la pensée des hommes de l’époque médiévale.
Ainsi, les manuscrits du Mont Saint-Michel ne cessent de chercher inspiration et autorité dans les textes des romains.
Les traces sont partout. On multiple donc les copies, les traductions et les commentaires de documents issus de l’Antiquité. Contrairement à une idée reçue, jamais cette période n’est négligée ou laissée de côté durant le Moyen Âge.
Avec la relecture scientifique de Jean-Pierre Caillet, professeur émérite spécialisé dans les contacts et les échanges entre Byzance et le monde occidental. Il s’est intéressé, notamment, aux survivances de l’Antiquité dans les arts du Moyen Âge.
Cicéron, De l’orateur
Loire, deuxième tiers du IXe siècle
 icéron connait une éducation rhétorique et juridique, mais aussi philosophique. Nous en connaissons beaucoup sur sa vie d’avocat durant les guerres civiles qui marquent la fin de la République en crise. Issu d’une famille non noble, il est le premier des siens à entamer une carrière politique à Rome du temps de César.
icéron connait une éducation rhétorique et juridique, mais aussi philosophique. Nous en connaissons beaucoup sur sa vie d’avocat durant les guerres civiles qui marquent la fin de la République en crise. Issu d’une famille non noble, il est le premier des siens à entamer une carrière politique à Rome du temps de César.
Fin orateur, il était convaincu qu’on peut gouverner la Cité par la parole. On sait qu’il apprenait par cœur l’introduction et quelques passages difficiles de ses interventions publiques. Le reste était improvisé. De manière générale, Marcus Tullius Cicero est connu pour la grande diversité de son œuvre. Il rédige notamment des traités théoriques, dont le De oratore, organisé comme un dialogue.
Dans ce manuscrit divisé en trois livres, il pose le problème fondamental de l’alliance entre rhétorique et philosophie, à l’aube de son expérience. Comme on peut le voir sur cette double page, ce volume qui ne comprend que des écrits de Cicéron est copié par deux mains différentes. Ici, il est aisé de distinguer le comblement d’une lacune par l’un des copistes.
Épître de Pierre (Nouveau Testament)
Mont Saint-Michel, v. 1224-1236
 ur cette double page, on rencontre un P (« Petrus ») avec une longue prolongation marginale. Cette lettre historiée montre saint Pierre, lisant et tenant une grande clé (qui représente le pouvoir délégué à l’Église). Né juif en Galilée, cet apôtre est considéré comme le premier évêque de Rome.
ur cette double page, on rencontre un P (« Petrus ») avec une longue prolongation marginale. Cette lettre historiée montre saint Pierre, lisant et tenant une grande clé (qui représente le pouvoir délégué à l’Église). Né juif en Galilée, cet apôtre est considéré comme le premier évêque de Rome.
Si la paternité de la rédaction de l’épître attribué à Pierre est, désormais, largement remise en cause, l’initiale est en rapport direct avec le texte. C’est bien ce livre qui semble attester de la présence de Pierre à Rome, si on accepte que la cité soit désignée péjorativement comme une Babylone, corrompue et idolâtre. Toutefois, on ne dispose que de peu d’éléments sur le personnage historique et son martyre.
Or, celui-ci est essentiel, puisqu’il signerait l’accomplissement d’une prophétie de Jésus. Néanmoins, là encore, les sources sont souvent trop tardives pour démontrer qu’il a bien été victime des persécutions de Néron en 64, à la suite du grand incendie de Rome.
Origène, Homélie sur la Genèse Traduction de Rufin d’Aquilée
troisième quart du XIIe siècle
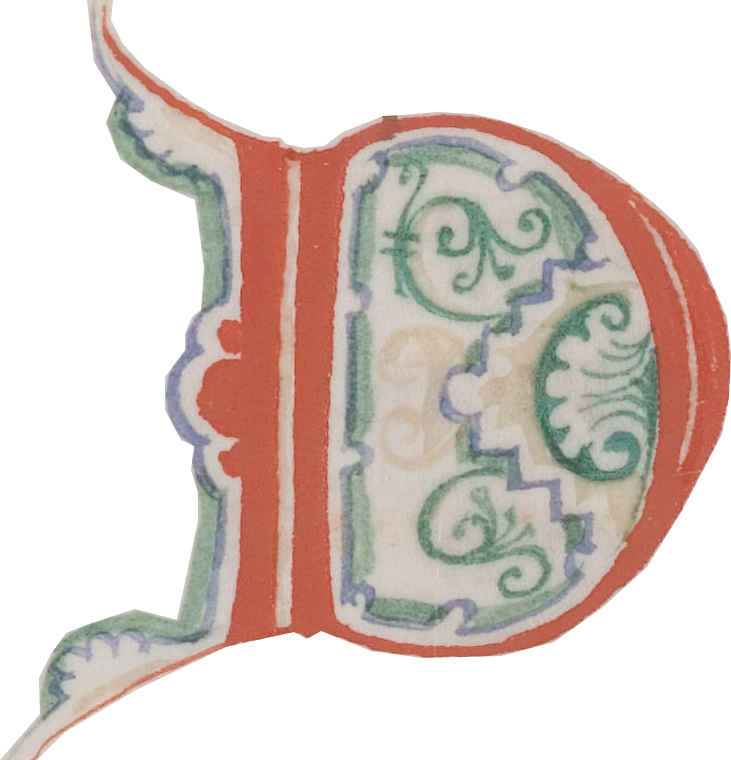 urant sa vie, Origène connait les différentes persécutions des empereurs romains du IIe et IIIe siècles. Encore jeune, il assiste à la mort en martyr de son père. La rigidité des mœurs qu’il s’applique à lui-même l’aurait incité à se castrer pour éviter la tentation. Après une vie de voyages, d’enseignements et de fuites, il est emprisonné et torturé.
urant sa vie, Origène connait les différentes persécutions des empereurs romains du IIe et IIIe siècles. Encore jeune, il assiste à la mort en martyr de son père. La rigidité des mœurs qu’il s’applique à lui-même l’aurait incité à se castrer pour éviter la tentation. Après une vie de voyages, d’enseignements et de fuites, il est emprisonné et torturé.
Sous des formes très variées (commentaires, homélies, scholies ou notes), Origène a tenté d’expliquer l’ensemble de la Bible. Toutefois, rédigées en grec, ses œuvres ont finalement été condamnées après son décès. Pour l’essentiel, ses travaux ne sont connus que par l’intermédiaire de traductions latines du IVe siècle.
En dehors de cette belle lettrine I (« in »), ce volume est peu enluminé puisqu’il est certainement destiné avant tout à l’étude. Celle-ci se compose d’un réseau d’entrelacs sur fond bleu. Le choix d’associer ce Père de l’Église à un singe n’est pas anodin. Il s’agit d’un animal peu représenté à l’époque de cette copie, puisqu’il est jugé ambiguë (ni tout à fait positif, ni complètement négatif).
La passion de saint Maximilien
Abbaye de Saint-Riquier, XIIIe siècle
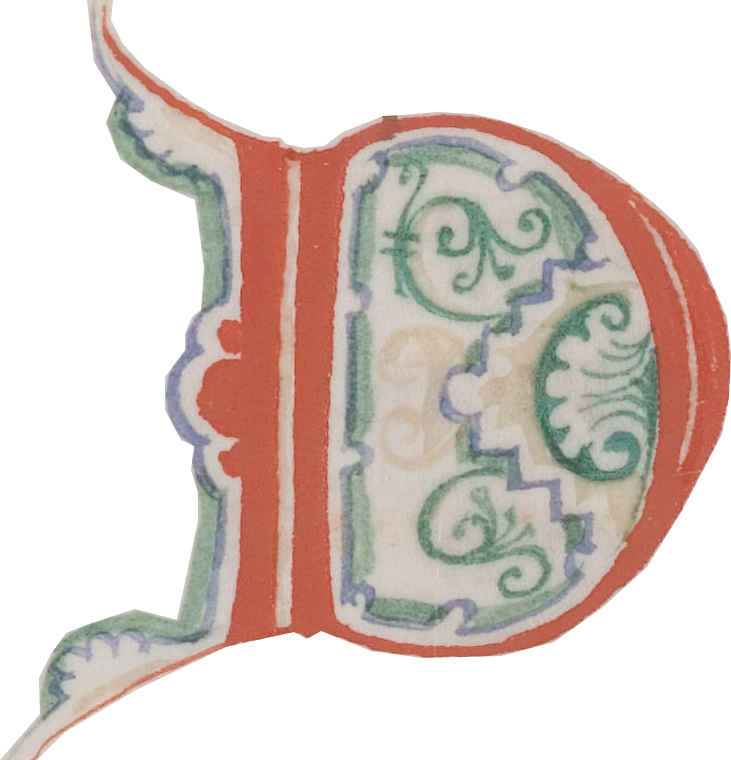 urant l’époque médiévale, le culte des saints est un aspect central de la spiritualité. Ainsi, les Vies de saints sont utiles à plus d'un titre :
urant l’époque médiévale, le culte des saints est un aspect central de la spiritualité. Ainsi, les Vies de saints sont utiles à plus d'un titre :
Sur cette double page, la vie de Maximilien est présentée. Né en 273, il est le fils d’un vétéran. Toutefois, il refuse de servir dans l’armée romaine qui occupe la Numidie. Comme le souligne directement ce manuscrit, à l’âge de 21 ans, il refuse de porter les armes, en raison de ses convictions religieuses. Ce saint fêté le 12 mars est condamné à mort par le proconsul parce qu’il refuse de revenir sur sa position.
Rufin d’Aquilée, Prologue sur le commentaire d’Origène
XIIIe siècle
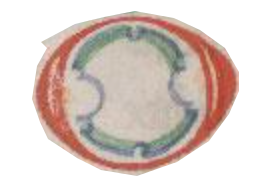 riginaire de Concordia, Rufin a suivi des études à Rome, avant une vie partagée entre voyages, communautés religieuses et études. Il revient finalement dans la capitale de l’Empire en 397. Rufin d’Aquilée se retire finalement dans un monastère, avant de devoir fuir face à l’invasion Wisigoth.
riginaire de Concordia, Rufin a suivi des études à Rome, avant une vie partagée entre voyages, communautés religieuses et études. Il revient finalement dans la capitale de l’Empire en 397. Rufin d’Aquilée se retire finalement dans un monastère, avant de devoir fuir face à l’invasion Wisigoth.
Dans ce prologue destiné à introduire son œuvre de traduction, Rufin se place en défenseur de la pensée d’Origène. Selon lui, les controverses autour de ce dernier résultent d’incompréhensions du texte original. Toutefois, dans ses propres traductions, Rufin d’Aquilée préfère omettre des éléments « altérés » pour les substituer par d’autres passages.
Dans ce prologue, il demande aussi aux copistes de ne pas modifier le texte et de respecter attentivement la ponctuation. Sur cette page, il semble avoir été écouté. On trouve quelques ratures et des corrections dans la marge. Ici, par exemple, un signe de renvoi permet de rectifier « originem » (pour « origine ») en « Origenem » (dans le sens d’« Origène »).
Ambrosiaster, Commentaire sur saint Paul
XIIe siècle
 mbrosiasteur fait figure d’énigme qui a fait couler beaucoup d’encre. Ce que l’on sait de lui se résume à quelques mots : il écrit sous le pontificat du pape Damase Ier (366-384). Il a donc connu les dernières décennies de l’Empire romain unifié.
mbrosiasteur fait figure d’énigme qui a fait couler beaucoup d’encre. Ce que l’on sait de lui se résume à quelques mots : il écrit sous le pontificat du pape Damase Ier (366-384). Il a donc connu les dernières décennies de l’Empire romain unifié.
On copie, ici, ses commentaires sur treize Épîtres de Paul de Tarse, dans lesquels il fait un rapprochement avec les préoccupations de ses contemporains. La copie de ce manuscrit est illustrée par une lettrine P (« Principia »), alors que la seconde – plus petite – représente saint Paul (« Paulus »). Aux couleurs rouge et bleu, rehaussées de vert, on rencontre un dragon à tête humaine qui avale un serpent. L’entrelacement de ces figures monstrueuses suggère qu’il est difficile d’identifier lequel des deux incarne le démon.
En marge, on trouve un second hybride anthropomorphe. L’humain aux traités déformés est fusionné avec un oiseau aux pieds palmés. Ces écarts à la norme servent à montrer le dérèglement face à l’ordre.
Ambroise de Milan, Lettre (XVIII)
XIIe siècle
 ngagé dans une controverse de haute volée, Ambroise, l’évêque de Milan, est chargé par le pape Damase de défendre la position chrétienne auprès de l’Empereur. Par écrits interposés, il s’oppose ici à Symmaque qu’il connait et estime par ailleurs.
ngagé dans une controverse de haute volée, Ambroise, l’évêque de Milan, est chargé par le pape Damase de défendre la position chrétienne auprès de l’Empereur. Par écrits interposés, il s’oppose ici à Symmaque qu’il connait et estime par ailleurs.
Ce dernier est un préfet de Rome. Il s’oppose à l’abolition des privilèges païens par l’Empereur Gratien. Cette décision datant de 382 provoque un véritable débat au sein du Sénat. L’aristocrate romain met particulièrement en avant le culte supprimé de la Victoire qui se tenait à la Curie de Rome. Il fait des chrétiens qui se réjouissent de la suppression de ce culte des amis des barbares.
Dans sa riposte, Ambroise inverse l’accusation, en affirmant que ce sont bien les païens qui seraient semblables aux barbares, puisqu’ils ignorent le christianisme. La lettre d’Ambroise est simplement mise en avant grâce à une initiale C (« CUM ») de couleur rouge, vert et jaune.
Polémius Silvius, Registre des provinces et cités de la Gaule
Mont Saint-Michel, vers 1075-1095
 ivant au Ve siècle, Polémius Silvius est probablement d’origine gauloise. Il pourrait être un théologien renommé de son temps. À la fin du IVe siècle, sa Noticia Galliarum découpe la Gaule romaine en dix-sept provinces, avec cent quinze civitates, sept castra et un portus.
ivant au Ve siècle, Polémius Silvius est probablement d’origine gauloise. Il pourrait être un théologien renommé de son temps. À la fin du IVe siècle, sa Noticia Galliarum découpe la Gaule romaine en dix-sept provinces, avec cent quinze civitates, sept castra et un portus.
On connait plus d’une centaine de copies de cet ouvrage, ce qui atteste de son importance durant le Moyen Âge. Celle présentée ici comprend des commentaires entre les lignes ajoutés de la main de l’abbé Robert de Torigni (v. 1110-1186). Il y corrige certains noms de provinces.
Comme souvent sur les manuscrits de cette époque au Mont, la double page propose une colonne occupée par le titre, avec une alternance entre le rouge vif (sulfure de mercure) et le vert (pigment à base de cuivre). Avec des initiales bicolores de même couleur, le décor secondaire est également représentatif de cette période.
Trois leçons pour la fête de s. Léon pape
XVe siècle
 ape de 440 à 461, Léon Ier le Grand a été le témoin du délitement de l’Empire romain. On ne sait presque rien de la vie de ce Toscan avant son pontificat. Vers l’âge de 70 ans, après 12 ans en tant que pape engagé contre les hérésies, il rencontre Attila, près de Mantoue.
ape de 440 à 461, Léon Ier le Grand a été le témoin du délitement de l’Empire romain. On ne sait presque rien de la vie de ce Toscan avant son pontificat. Vers l’âge de 70 ans, après 12 ans en tant que pape engagé contre les hérésies, il rencontre Attila, près de Mantoue.
Le souverain des Huns s’apprête alors à marcher sur Rome, mais se laisse convaincre et se retire d’Italie, en échange d’un tribut. Ce n’est pas le cas de Genséric et des Vandales. En 455, ses troupes pillent la cité pendant 15 jours. Le souverain pontife réussit néanmoins à négocier que la ville ne soit pas incendiée.
La lettre ornée L (« Leo papa ») ouvre les trois leçons, qui sont accompagnées par un répons et un verset. Dans la liturgie montoise, saint Léon est célébré le 28 juin. L’ensemble de l’ouvrage propose un décor assez sobre, avec des initiales de couleur rouge et bleue.
Sidoine Apollinaire, Lettres
probable production normande, XIIe siècle
 idoine Apollinaire (v. 431-v. 487) est issu d’une famille de grands aristocrates de la Gaule romaine. Son éducation soignée lui apporte une parfaite maîtrise de la rhétorique. Il est préfet de Rome et patrice en 468. Deux ans plus tard, à la fin de sa vie, il devient évêque de Clermont, citée menacée par les Wisigoths (peuples germaniques).
idoine Apollinaire (v. 431-v. 487) est issu d’une famille de grands aristocrates de la Gaule romaine. Son éducation soignée lui apporte une parfaite maîtrise de la rhétorique. Il est préfet de Rome et patrice en 468. Deux ans plus tard, à la fin de sa vie, il devient évêque de Clermont, citée menacée par les Wisigoths (peuples germaniques).
On connait deux recueils de Lettres (Epistulae) publiées entre 469 et 481. Au nombre de 146, ces lettres sont réparties en neuf livres. Elles sont l’œuvre d’un religieux lié à un pouvoir de l’Empire qui s’effrite. Avec raffinement, il y offre un tableau d’une époque « émouvante et tragique », selon ses propres mots.
Du point de vue du style, sa correspondance apparaît comme moins alambiquée que sa poésie. Ses lettres demeurent, néanmoins, très recherchées et parfois complexes. Il y montre continuellement son attachement à la culture antique romaine, alors en plein bouleversement.
Boèce, Institution musicale
vers 988-1006
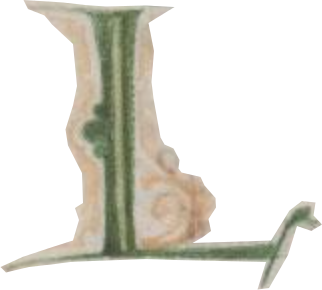 ' histoire du De institutione musica de Boèce n’est pas commune. Ainsi, il faut attendre trois siècles après sa rédaction pour que l’ouvrage connaisse un véritable succès. Par la suite, entre le VIIIe et le XVe siècle, on compte près de 170 manuscrits qui le copient.
' histoire du De institutione musica de Boèce n’est pas commune. Ainsi, il faut attendre trois siècles après sa rédaction pour que l’ouvrage connaisse un véritable succès. Par la suite, entre le VIIIe et le XVe siècle, on compte près de 170 manuscrits qui le copient.
Ce manuscrit copié au tournant de l’an mil présente une écriture lombardique, ce qui pourrait suggérer une production en dehors du Mont. Et pour cause, le terme de « lombardique » évoque un style d’écriture issu de Lombardie, dans l’Italie médiévale. Celle-ci se caractérise par une forme cursive avec des lettres aux formes arrondies.
Boèce, l’auteur de ce traité, a connu les derniers feux de l’Empire romain. En 485, il épouse la fille du consul Symmaque et devient lui-même consul en 510. Par la suite, il est nommé ministre à Rome de Théodoric, le roi des Ostrogoths. Finalement, en 523, il est exilé, avant d’être exécuté parce qu’il est soupçonné d’entretenir des liens avec l’empereur de Byzance.
Justinien, Code
XIIe siècle
 la fin du Ve siècle, lors de la naissance de Justinien Ier, l’Empire romain se limite à l’Orient et la capitale est désormais Constantinople, la nouvelle Rome. Lorsqu’il accède au pouvoir, le Trésor est à nouveau plein et l’Empire apparait encore comme une véritable puissance.
la fin du Ve siècle, lors de la naissance de Justinien Ier, l’Empire romain se limite à l’Orient et la capitale est désormais Constantinople, la nouvelle Rome. Lorsqu’il accède au pouvoir, le Trésor est à nouveau plein et l’Empire apparait encore comme une véritable puissance.
Justinien règne longuement (527-565) et permet à l’Empire romain d’Orient de s’étendre. Il rétablit le cadre juridique de l’ancienne Rome, en tenant compte de la christianisation. Ainsi, dès le début de son règne, il met en place une commission destinée à réviser le droit. Publié en 529, le Code Justinien est remanié dès 534. Toutefois, rédigée en grec, l’œuvre législative de l’Empereur continue dans les décennies suivantes.
Si le Code a peu à peu été remplacé par d’autres compilations ultérieures, la redécouverte de ce texte en Italie, au XIe siècle, a suscité un renouveau du droit en Occident. C’est ce qui explique le nombre important de copies de ce manuscrit dans le monde médiéval.