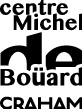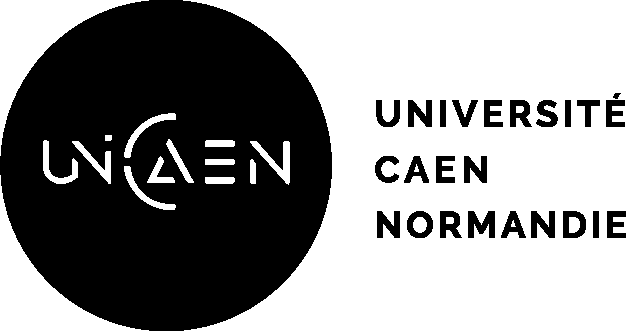Les coutumes de la vicomté de l’Eau de Rouen
Ce recueil de coutumes recense les usages relevant de la vicomté de l’eau de Rouen, une juridiction royale dont la compétence s’étend à la ville de Rouen et à sa banlieue, ainsi qu’à « l’eau de Seine » depuis Paris jusqu’à l’estuaire1. Son rôle premier est de percevoir les revenus du domaine sur les activités commerciales, comme en témoigne son coutumier : de nombreux tarifs de coutumes (au sens de taxes) prélevées sur les transactions commerciales et les droits de passage y côtoient les règles d’organisation interne de la vicomté de l’eau et les procédures s’appliquant devant sa cour.
Les coutumes de la vicomté de l’eau forment un texte assez long, rédigé en langue vernaculaire et structuré en chapitres. Il est composé de plusieurs couches d’écriture, produites successivement à la fin de la mouture préexistante à la manière d’un registre qui se construit progressivement. Mises par écrit à partir du xiiie siècle, les coutumes connaissent, sans doute dans le dernier quart du siècle, un premier aboutissement : la structure du texte se fixe alors et forme un canevas repris à toutes les étapes ultérieures de la tradition. Une table des chapitres et un prologue sont également introduits à ce moment-là.
Ce dernier manifeste la volonté des producteurs de cette première version identifiable de créer un texte de référence en vue de garantir l’équité de tous les acteurs ayant affaire à la vicomté de l’eau, probablement dans un contexte d’abus et de perceptions illicites de la part des fermiers de la vicomté de l’eau. D’ailleurs, la politique royale de contrôle des officiers royaux initiée au milieu du xiiie siècle n’est peut-être pas sans influence sur la production de cette version. Pour autant aucun signe d’authentification ne donne de caractère officiel à ce « coutumier primitif » et ses producteurs ne se nomment pas. L’analyse suggère cependant que des praticiens de la vicomté de l’eau en sont à la fois les producteurs et les premiers destinataires : confrontés à la complexité du droit dans leur juridiction, ils constituent un instrument pratique à même d’en faciliter l’administration2.
Le coutumier est par la suite remanié et surtout augmenté de nouveaux chapitres à plusieurs reprises, avant de prendre force de loi en 1554 par un édit d’Henri ii. Plusieurs versions sont ainsi connues, dont la plupart ne mentionnent pas de date de rédaction, ni d’autorité au nom de laquelle le coutumier est mis par écrit. Deux versions font cependant exception : l’une est rédigée sur ordre de l’Échiquier en 1509 ; l’autre est conservée dès la fin du xve siècle à la Chambre des comptes de Paris. Cette dernière version est en effet copiée à plusieurs reprises par des clercs de la Chambre à la demande de marchands ou de fermiers de la vicomté de l’eau, comme en témoignent les préambules reportés au début de certains exemplaires conservés.
En tout quatorze manuscrits, réalisés entre les xiiie et xviie siècles, témoignent de six versions distinctes du coutumier, elles-mêmes mises par écrit entre le xiiie siècle et la première moitié du xvie siècle. Certains manuscrits sont exclusivement dédiés au coutumier de la vicomté de l’eau, à l’image du codex le plus ancien du corpus (BNF, fr. 5966, fin du xiiie siècle), un livre juratoire qui aurait appartenu un temps à la vicomté de l’eau3. D’autres volumes constituent des recueils de documents plus larges, essentiellement de nature coutumière ou juridique, mais où le coutumier rouennais semble toujours être l’objet d’intérêt principal des commanditaires des codices. Dans chacun d’eux, le coutumier de la vicomté de l’eau se trouve associé aux mêmes Jugements ou Rôles d’Oléron, une jurisprudence maritime en vigueur sur la côte atlantique4, et dont Charles de Beaurepaire affirme, de solides arguments à l’appui, qu’ils « sont le complément nécessaire des dispositions législatives insérées dans le Coutumier de la vicomté de l’eau »5.
* Note sur les éditions proposées :
Les éditions présentées ici ont été réalisées dans le cadre de la thèse de Laure Cébe, La mise en écriture d’un droit coutumier. Les coutumes de la vicomté de l’eau de Rouen (xiiie-xvie siècle), Laurence Jean-Marie (dir.), Université de Caen Normandie, 20246. Elles reposent sur l’établissement d’un stemma codicum du coutumier. Celui-ci a permis l’identification des six versions du texte, qui font chacune fait l’objet d’une édition indépendante. Cinq d’entre elles s’appuient sur un unique témoin. Seule la version de 1509 propose un apparat rendant compte des variantes d’un second témoin jugé utile. Cet apparat est sélectif, puisqu’il ne fait apparaître que les variantes de sens par rapport au manuscrit de base. Les variantes orthographiques, les particularités linguistiques et les formulations distinctes ne changeant pas le sens en sont exclues.
En effet, l’objectif de ces éditions est avant tout de donner à lire toutes les coutumes et de rendre compte de la spécificité de chaque version, et non de proposer des éditions « reconstructionnistes » des subarchétypes. La perspective éditoriale retenue s’entend dans la fidélité aux témoins sélectionnés, notamment du fait des caractéristiques du texte : son enchevêtrement, l’ordre mouvant d’apparition des coutumes d’un témoin à l’autre, ses variantes graphiques omniprésentes.
Face à un texte d’un abord difficile, ce choix d’édition a l’avantage de la clarté, d’éviter de présenter un texte confus à l’apparat considérable (le nombre élevé des variantes graphiques aurait alourdi les éditions en conséquence), et en définitif difficile à prendre en main, alors même que l’objectif est que le lecteur puisse se saisir de cette source. Ces éditions s’inscrivent donc dans une perspective historienne, où l’équilibre entre intelligibilité et fidélité à la source a été privilégié.
Cette volonté d’intelligibilité a guidé une autre caractéristique de ces éditions. Celles-ci intègrent en effet en note le sens qui apparaît dans les autres versions lorsqu’un segment textuel est particulièrement incompréhensible. Le sens proposé repose sur l’analyse des différentes versions du coutumier et sur leur traduction, elle-même réalisée dans le cadre de la thèse de Laure Cébe7. Les recherches sur la signification des coutumes ont d’ailleurs pleinement participé au travail éditorial, en particulier en permettant l’identification des scansions du texte médiéval ou encore la distinction des segments textuels fautifs de ce qui relève d’évolutions de fond. Ainsi, la compréhension du sens du texte a permis d’évaluer si un témoin était massivement plus fautif qu’un autre et participé du choix des témoins de base pour les éditions.
Enfin, considérant que les éléments visuels de la mise en page influent directement sur les structures de sens du contenu textuel, ces éditions rendent compte de l’organisation visuelle des manuscrits de base. La mise en forme des unités textuelles, par leur hiérarchisation plus ou moins détaillée et leur mise en page, traduit les conceptions d’organisation du texte, dont il est possible de restituer la logique dans ces éditions.
1. Si l’on en croit le coutumier. Toutefois, le ressort de la vicomté de l’eau s’applique plus probablement sur le fleuve depuis le pont de Mantes jusqu’à Caudebec-en-Caux. À partir du milieu du xvie siècle, sa juridiction s’exerce non seulement sur la basse Seine, mais aussi sur les affluents du fleuve (Epte, Andelle, Eure, Iton et Risle). À ce sujet voir : Michel Mollat, « Réflexions sur quelques constantes de l’histoire du port de Rouen », Connaître Rouen III (3), 1976, p. 1‑19. Par ailleurs, cette zone correspond à celle sur laquelle la vicomté de l’eau peut poursuivre les contrevenants, et non à une zone sur laquelle elle exerce une autorité exclusive. Elle prélève également des droits de passage, d’embarquement et débarquement de marchandises, dans plusieurs ports fluviaux se situant dans cet espace.
2. Laure Cébe, La mise en écriture d’un droit coutumier. Les coutumes de la vicomté de l’eau de Rouen (xiiie-xvie siècle), vol. 1/2, Thèse de doctorat, Laurence Jean-Marie (dir.), Université de Caen Normandie, 2024, p. 147-156.
3. Charles de Beaurepaire, De la vicomté de l’eau de Rouen et de ses coutumes au xiiie et au xive siècles, Évreux, Hérissey, 1856, p. 271 ; Laure Cébe, La mise en écriture d’un droit coutumier, op. cit., vol. 1/2, p. 272-274.
4. À ce sujet, voir notamment : Gérard Guyon, « Les coutumes pénales des Rôles d’Oléron, un droit pénale maritime original ? », in: Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2003, p. 327-343 ; Philippe-Jean Hesse, « Éléments d’histoire des sources du droit maritime français », Annuaire de droit maritime et océanique XVI, 1998, p. 19-30.
5. Charles de Beaurepaire, De la vicomté de l’eau de Rouen, op. cit., p. 393.
6. L’encodage de deux versions du coutumier a été réalisé avec la participation de Lény Retoux, alors ingénieur d’études dans le cadre du programme RIN Norécrit (Université de Caen Normandie, Craham).
7. Laure Cébe, La mise en écriture d’un droit coutumier, op. cit., vol. 2/2, p. 171-220.
Responsabilités
Laure Cébe (éd.)
Laurence Jean-Marie (éd.)
Lény Retoux (éd.)
Centre Michel de Bouärd
laure.cebe@unicaen.fr
laurence.jean-marie@unicaen.fr
leny.retoux@unicaen.fr